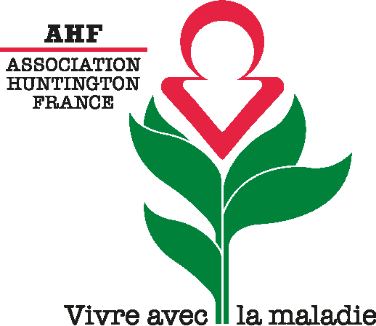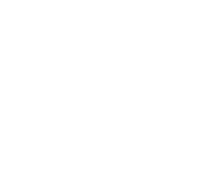Trauma, Traumatisme et Stress Post-Traumatique
Le trauma désigne un choc violent subi par une personne et qui va provoquer une blessure physique et/ou psychique. Le traumatisme désigne les conséquences sur le psychisme de ce choc.
Le terme « trauma » regroupe de nombreux évènements que l’on pourrait vouloir, à tort, hiérarchiser en termes de « gravité ». Or, qu’il s’agisse d’une agression, d’un attentat, d’un accident de voiture, d’un diagnostic de maladie chronique, d’un divorce ou d’un licenciement, tous ces évènements peuvent engendrer les mêmes conséquences psychologiques.
Leur point commun est d’être subis par l’individu, de déborder sa capacité à réagir sur le moment.
La manière dont l’évènement traumatique est émotionnellement intériorisé, ancré dans la mémoire, va être à l’origine de l’intensité du stress post-traumatique qui en découle et qui va se cristalliser autour de ressentis tels que l’impuissance/perte de contrôle, la peur de mourir, la culpabilité, le sentiment d’insécurité et sa transformation en un état constant d’hypervigilance.
Un trauma peut être un évènement circonscrit dans le temps, comme un accident de voiture par exemple. Mais il peut également survenir par répétition, par une exposition régulière ou quotidienne à l’évènement (violences intrafamiliales ou harcèlement par exemple).
Un stress post-traumatique peut engendrer plusieurs symptômes : des flashs (comme des images partielles qui s’imposent à la conscience), une anxiété, des cauchemars. Au quotidien, ce stress peut se traduire par un état d’hypervigilance, un stress chronique, des affects dépressifs, des troubles du sommeil et par une perte d’estime et de confiance en soi.
Pourquoi parler de traumatisme dans le cadre de la maladie de Huntington ? Le trauma peut se situer à différents moments du vécu avec la maladie : au moment du diagnostic, au moment de recevoir le résultat du test. Ou encore, en tant que proche, ou porteur, confronté au sentiment d’impuissance que l’on peut être amené à ressentir au quotidien avec une personne malade. Il est important d’en avoir conscience, d’en comprendre les mécanismes, pour mieux identifier les émotions et les déclencheurs du stress afin de mieux les gérer, étape nécessaire pour agir sur les effets du trauma et retrouver sa capacité d’action.
Une fois les émotions identifiées, des actions peuvent plus facilement être menées en faveur du bien-être physique et mental. Retrouver du sens, une capacité à se projeter, ses valeurs et ses priorités. La question de fond étant toujours « quelle est ma marge de manœuvre dans un contexte donné où je ne maîtrise pas tous les facteurs ? ». Les outils possibles : groupes de parole, accompagnement psychologique, méditation, sophrologie, sans oublier l’importance de l’activité physique et du maintien d’une vie sociale ; des techniques thérapeutiques ayant fait leurs preuves dans le traitement du stress post-traumatique : EMDR*, hypnose.
__
Par Emmanuelle Busch, psychologue
Juin 2025
* En anglais : Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing ce qui signifie la désensibilisation et le retraitement (de l’information) par les mouvements oculaires